L'Avortement
![]() Télécharger le document
---> Document Word
Télécharger le document
---> Document Word
D'autres documents :
![]() Taux de fécondité par age en
France (chiffres) ---> Document
Excel
Taux de fécondité par age en
France (chiffres) ---> Document
Excel
![]() Taux de fécondité par age en
France (graphique) ---> Image
Taux de fécondité par age en
France (graphique) ---> Image
![]() Natalité et fécondité dans
divers pays
---> Document Excel
Natalité et fécondité dans
divers pays
---> Document Excel
IVG
La réglementation :
Les lois des 17 janvier 1975, 31 décembre 1979 et 4 juillet 2001 autorisent la pratique de l'IVG sous certaines conditions précises.
L'IVG peut être pratiquée à la demande d'une femme enceinte que son état place dans "une situation de détresse" : elle est seule juge de cette situation. C'est avant tout une décision personnelle.
L'intervention
doit être impérativement pratiquée :
![]() par
un médecin
par
un médecin
![]() dans
un établissement d'hospitalisation public ou établissement d'hospitalisation
privé agréé
dans
un établissement d'hospitalisation public ou établissement d'hospitalisation
privé agréé
![]() avant
la fin de la douzième semaine de grossesse (soit 14 semaines
après le début des dernières règles) : il s'agit d'un délai impératif
maximum prescrit par la loi
avant
la fin de la douzième semaine de grossesse (soit 14 semaines
après le début des dernières règles) : il s'agit d'un délai impératif
maximum prescrit par la loi
Ou, depuis juillet 2004, pour la méthode médicamenteuse seulement :
![]() par
un médecin gynécologue ou généraliste agréé
par
un médecin gynécologue ou généraliste agréé
![]() dans
son cabinet
dans
son cabinet
![]() avant
la fin de la cinquième semaine de grossesse (soit 7 semaines
après le début des dernières règles).
avant
la fin de la cinquième semaine de grossesse (soit 7 semaines
après le début des dernières règles).
Les méthodes :
Deux
techniques, essentiellement, sont
possibles, selon votre âge, le terme de la grossesse et votre état de
santé :
1. la
technique instrumentale
2. la
méthode médicamenteuse
Attention,
tous les centres d'IVG n'offrent pas ces deux possibilités.
Si vous avez choisi particulièrement l'une ou l'autre méthode,
renseignez-vous avant.
Si vous avez opté pour la méthode médicamenteuse, celle-ci est réalisable
auprès des médecins gynécologues et généralistes agréés depuis juillet 2004.
1. La technique instrumentale
C'est la méthode dite par aspiration, qui peut être suivie le cas échéant d'un curetage.
Elle peut se pratiquer sous anesthésie générale ou locale. L'anesthésie locale donne des conditions de confort et de sécurité tout à fait satisfaisantes et des complications moins fréquentes que l'anesthésie générale.
Aujourd'hui, grâce à l'amélioration des techniques et à l'expérience des médecins, les complications majeures de l'IVG sont devenues exceptionnelles.
2. La méthode médicamenteuse
Il s'agit de la technique utilisant le RU 486 (ou mifépristone) par voie orale, associé à des prostaglandines. Ce produit bloque l'action de la progestérone, hormone nécessaire au maintien de la grossesse. les prostaglandines augmentent les contractions de l'utérus.
Cette méthode ne nécessite aucune anesthésie ni aucune intervention instrumentale.
Elle ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la 5ème semaine de grossesse, soit 7 semaines après le début des dernières règles.
Cette méthode se déroule en 3 temps dans le centre d'IVG ou le cabinet de votre médecin gynécologue ou généraliste :
![]() 1ère
consultation : prise de 3 comprimés de RU 486, en présence du médecin du
centre d'IVG. Vous pouvez ensuite rentrer chez vous. Il peut survenir des
saignements importants : ils ne sont pas la preuve que la grossesse est
arrêtée ; il est donc obligatoire de se présenter à une 2ème consultation.
1ère
consultation : prise de 3 comprimés de RU 486, en présence du médecin du
centre d'IVG. Vous pouvez ensuite rentrer chez vous. Il peut survenir des
saignements importants : ils ne sont pas la preuve que la grossesse est
arrêtée ; il est donc obligatoire de se présenter à une 2ème consultation.
![]() 2 ème
consultation : 48 heures plus tard, administration de prostaglandines
par voie orale ou sous forme d'ovules. Ceci provoque des saignements, des
contractions utérines et l'expulsion de l'oeuf dans les heures suivantes.
Vous resterez hospitalisée sous surveillance médicale quelques heures.
2 ème
consultation : 48 heures plus tard, administration de prostaglandines
par voie orale ou sous forme d'ovules. Ceci provoque des saignements, des
contractions utérines et l'expulsion de l'oeuf dans les heures suivantes.
Vous resterez hospitalisée sous surveillance médicale quelques heures.
![]() 3 ème
consultation : une semaine après la prise des comprimés, il est
indipensable de revenir dans le même établissement pour une consultation
médicale de contrôle. Il faut savoir aussi que les saignements durent en
général une semaine, parfois plus longtemps.
3 ème
consultation : une semaine après la prise des comprimés, il est
indipensable de revenir dans le même établissement pour une consultation
médicale de contrôle. Il faut savoir aussi que les saignements durent en
général une semaine, parfois plus longtemps.
En cas d'échec de cette méthode (< 5 % des cas), c'est-à-dire que la grossesse n'est pas arrêtée, il est impératif de procéder à une aspiration et à un curetage.
Le coût d'une IVG :
Remboursement :
L'IVG est remboursée à 80 % par la Sécurité Sociale, elle est strictement tarifée. La plupart des mutuelles prennent en charge le ticket modérateur, c'est à dire les 20 % qui restent à la charge de l'assuré.
Confidentialité ...
Si vous êtes ayant droit d'un autre assuré (votre conjoint, en général) et que vous ne souhaitiez pas que celui-ci soit informé par le biais du remboursement, vous pouvez obtenir une aide médicale : une assistante sociale, le centre de planification, l'association départementale du Mouvement du Planning Familial ou l'établissement d'information ou l'établissement où sera pratiquée l'IVG vous aideront dans cette démarche.
Pour les mineures
Les frais afférents à l'IVG d'une mineure pour laquelle le consentement parental n'a pu être recueilli sont pris en charge par l'Etat, selon une procédure garantissant l'anonymat.
La contraception et l'IVG en France, en Europe et dans le monde :
![]() En
France :
En
France :
Situation des femmes ayant recours à l'IVG en 1996 en France (en %)
| Age | |
| Inférieur ou égal à 17 ans |
4,1 |
| 18-19 ans |
7,2 |
| 20-24 ans |
23,6 |
| 25-29 ans |
22,3 |
| 30-34 ans |
20,1 |
| 35-39 ans |
14,9 |
| Supérieur ou égal à 40 ans |
7,0 |
| Non précisé |
0,8 |
| Situation matrimoniale de fait |
|
| Seule |
45,7 |
| En couple |
45,0 |
| Non précisé |
9,3 |
| Situation professionnelle |
|
| En activité |
43,9 |
| Au chômage |
12,4 |
| Au foyer |
15,8 |
| Étudiante, élève |
23,8 |
| Non précisé |
4,1 |
| Nombre de naissances vivantes antérieures à l'IVG |
|
| 0 |
43,8 |
| 1 |
15,5 |
| 2 |
19,2 |
| Supérieur ou égal à 3 |
15,2 |
| Non précisé |
2,5 |
| Nombre d'IVG antérieures |
|
| 0 |
74,2 |
| 1 |
18,1 |
| Supérieur ou égal à 2 |
5,1 |
| Non précisé |
2,6 |
Courbes du nombre absolu et du nombre moyen d'interruptions de grossesse par femme de 1976 à 1997
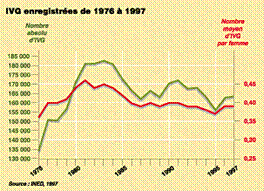
Carte du taux d'interruptions de grossesse par département en 1996
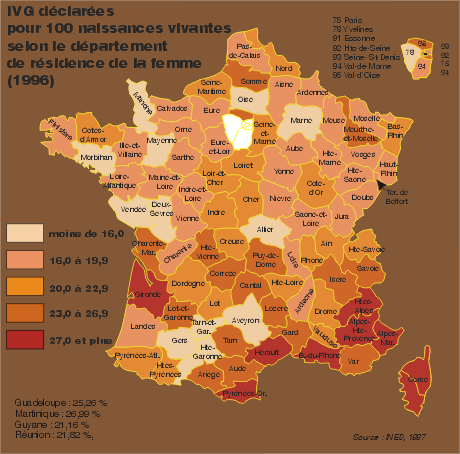
La France se caractérise par une large utilisation de la pilule contraceptive, complétée par un recours relativement fréquent (chez les femmes de plus de 35 ans) au stérilet.
Utilisation des différentes méthodes de contraception par tranche d'âge (en %)
| Age |
20/24 |
25/29 |
30/34 |
35/39 |
40/44 |
45/49 |
20/49 |
| Femmes utilisant une contraception dont |
69,5 |
68,5 |
68,6 |
71,1 |
65,1 |
44,5 |
65,0 |
| Pilule |
57,7 |
50,6 |
42,7 |
31,9 |
20,9 |
14,3 |
36,8 |
| Stérilet |
3,1 |
7,7 |
14,9 |
27,6 |
26,0 |
17,6 |
16,1 |
| Abstinence |
2,7 |
2,5 |
3,6 |
3,2 |
7,5 |
5,2 |
4,1 |
| Préservatif |
5,0 |
5,1 |
4,5 |
5,8 |
3,5 |
3,8 |
4,6 |
| Méthode locale |
0,3 |
0,2 |
0,7 |
0,2 |
1,6 |
1,0 |
0,6 |
| Retrait |
0,8 |
2,5 |
2,1 |
2,0 |
4,7 |
2,1 |
2,4 |
| Non précisée |
0 |
0 |
0,1 |
0,4 |
1,0 |
0,6 |
0,3 |
| Pas de méthode |
30,5 |
31,5 |
31,4 |
29,0 |
34,9 |
55,5 |
35,0 |
![]() En
Europe
En
Europe
En matière de délai légal de recours à l'IVG et d'autorisation parentale, la France apparaît aujourd'hui encore un des pays les plus restrictifs parmi ses voisins européens.
Délai légal du recours à l'IVG (en semaines de grossesse) et modalités en matière d'autorisation parentale pour les mineures dans les pays de l'UE :
| Pays | Quel est le délai légal de recours à l'IVG ? | L'autorisation parentale est-elle exigée ? |
| Allemagne | 12 (illégal mais dépénalisé jusqu'à 12 semaines) | Non |
| Autriche | 12 (jusqu'à 20 semaines en cas de risque pour la santé de la mère ou du fœtus) | Non |
| Belgique | 12 (dépénalisé en 1990) | Non |
| Danemark | 12 | Une commission peut s'y substituer |
| Espagne | 12 semaines, 22 en cas de malformations fœtales, sans délai en cas de grave danger pour la mère | Non |
| Finlande | 12 (jusqu'à 24 semaines en cas de risque pour la vie de la mère ou du fœtus) | Non |
| France | 10 | Oui |
| Grèce | 10 (jusqu'à 20 semaines en cas de viol) | Oui |
| Irlande | IVG non autorisée (sauf si la mère est en danger de mort) | Autorisation des parents ou d'une commission |
| Italie | 10 (si la santé de la mère est en danger) | Une commission peut s'y substituer |
| Luxembourg | 12 | Non |
| Pays-Bas | 22 (en cas de "situation intolérable") | Non |
| Portugal | IVG non autorisée (sauf si la mère est en danger de mort) | Oui |
| Royaume-Uni | 22 pour raisons sociales ou économiques, sans délai pour raisons médicales | Non |
| Suède | 16 | Non |
Les données internationales recueillies sur l'utilisation des moyens de contraception ne concernent que les femmes mariées, âgées de 15 à 44 ans, c'est-à-dire considérées en âge de procréer. Parmi ces femmes, 57 % déclarent aujourd'hui faire usage de contraceptifs manufacturés. Par ailleurs, la stérilisation représente le choix contraceptif de nombreuses femmes, mais elle est également mise en place assez fréquemment de manière abusive.
Les moyens contraceptifs masculins, préservatifs ou stérilisation, sont partout des recours très rares. C'est l'Asie de l'Est, la Chine surtout, puis l'Occident, qui utilisent le plus de contraceptifs. L'Afrique vient en dernier.
En matière d'interruption de grossesse, les lois et politiques, restrictives ou libérales, sont souvent contournées. C'est en Amérique latine, exception faite de Cuba, que la législation sur l'interruption de grossesse est la plus répressive ; c'est aussi la partie du monde où le nombre d'interruptions de grossesse est le plus élevé. On estime à 25 ou 30 millions d'interventions légales pratiquées annuellement dans le monde et à 20 millions le nombre d'avortements clandestins. Les pays dont la législation est très restrictive conservent généralement des clauses qui autorisent l'interruption volontaire de grossesse dans certains cas, notamment lorsque la vie de la mère est menacée. Mais nombre de ces pays ne prennent pas en compte les cas de viol ou d'inceste. Enfin, dans de nombreux pays, si l'IVG est autorisée, les femmes ont besoin du consentement de leur mari et certains pays peuvent limiter l'accès à cette opération en réduisant la prise en charge financière par l'État.
Divers :
Définitions :
Taux de fécondité :
c’est le rapport du nombre de naissances
vivantes de l'année à la population féminine moyenne de l'année.
Population féminine : femmes fécondes (entre 15 et 50 ans).
Indicateur conjoncturel de fécondité : ou somme des naissances réduites, mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés.
Quelles sont les techniques de l’assistance médicale à la procréation ?
Plusieurs techniques peuvent être utilisées en fonction du diagnostic d’infertilité posé. Leur point commun est d’avoir pour but de favoriser la rencontre des spermatozoïdes et des ovocytes en vue d’une fécondation. Le choix de l’une ou l’autre dépend de la quantité de spermatozoïdes fonctionnels et mobiles utilisables ou de la nature de leurs lésions, ainsi que de la perméabilité des voies génitales féminines. En outre, leur lourdeur, leurs risques et leur coût respectifs constituent également des critères d’orientation (voir annexe : nombre de tentatives d'AMP et ventilation suivant les techniques de l'année).
![]()
![]() L’Insémination
artificielle (IA) : la technique de premier recours
L’Insémination
artificielle (IA) : la technique de premier recours
![]()
![]() La
Fécondation in vitro (FIV) : une réponse de choix à l’hypofertilité féminine
et masculine
La
Fécondation in vitro (FIV) : une réponse de choix à l’hypofertilité féminine
et masculine
![]()
![]() L’Injection
intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) : la technique de choix en cas
de stérilité masculine
L’Injection
intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) : la technique de choix en cas
de stérilité masculine
![]()
Quelles questions pose l’AMP aux couples et à la société ?
Finalement, l’assistance médicale à la
procréation touche à ce que l’individu possède de plus intime, ce que
l’homme a de plus ancré dans son histoire : les origines de sa vie.
Dès lors, tous
les phénomènes qu’elle engendre ne peuvent être vraiment simples et les
chercheurs en sciences humaines ne sont pas moins concernés que les
biologistes et les généticiens par les bouleversements qu’elle introduit
dans les modes de procréation.
Insémination avec
sperme du conjoint (IAC)
ou de donneur (IAD),
Fécondation in vitro avec
transfert d’embryons (FIVETE),
mères porteuses (insémination
artificielle, accueil d’embryon), congélation d’embryons :
toutes ces modalités ont des conséquences profondes sur le vécu identitaire
de la « mère », du « père », de l’enfant, du tiers.